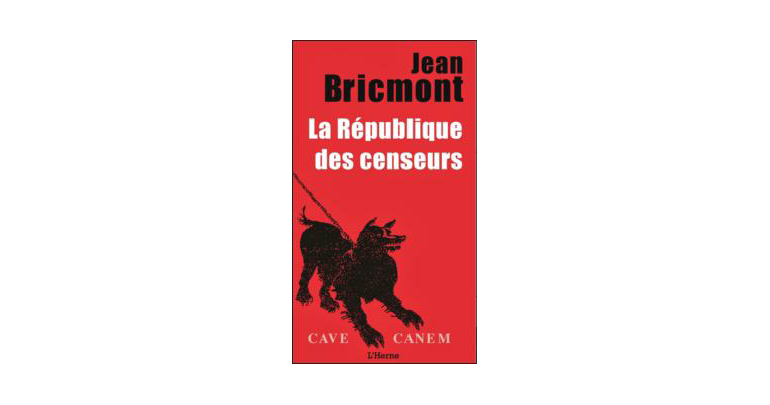Samedi dernier, une cour criminelle spécialisée en Tunisie a prononcé des sentences allant de 4 à 66 ans de réclusion dans le cadre d’une affaire impliquant des accusations de complot et de terrorisme. Parmi les condamnés figure le philosophe français Bernard-Henri Lévy, qui a été déclaré coupable par contumace et doit purger une peine de 33 ans.
Les autorités tunisiennes n’ont pas fourni de détails précis sur les accusations portées contre M. Lévy, mais des sources françaises ont suggéré qu’elles pourraient être liées à son lobbying en faveur d’Israël et à des allégations non prouvées concernant l’industrie du phosphate tunisienne.
Le procès a également condamné plusieurs figures importantes, dont :
– Kamel Eltaïef, un ancien proche de Ben Ali, qui a écopé de 66 ans ;
– Khayam Turki, militant politique, à 48 ans ;
– Noureddine Bhiri, ex-ministre de la Justice et membre du mouvement Ennahdha, condamné à 43 ans.
Les accusés ont été reconnus coupables de plusieurs infractions allant d’atteinte à la sûreté de l’État à incitation à la guerre civile. Parmi les peines encourues, on trouve aussi atteinte à la sécurité alimentaire et environnementale.
Depuis juillet 2021, le président Kaïs Saïed a pris plusieurs mesures controversées pour « protéger l’État contre un péril imminent ». Ces actions comprennent la suspension du Parlement, l’abolition du Conseil supérieur de la magistrature et des élections législatives anticipées. Bien que réélu en octobre 2024, ces décisions ont soulevé des inquiétudes concernant les libertés démocratiques.
Des organisations non gouvernementales (ONG) ainsi que des avocats de la défense ont vivement critiqué le procès pour son manque d’impartialité et pour une éventuelle instrumentalisation politique. Des rassemblements ont eu lieu devant le tribunal en soutien à l’exigence d’audiences publiques, mais ces demandes n’ont pas été satisfaites.
À ce jour, aucune autorité judiciaire tunisienne ou gouvernementale n’a officiellement commenté la sentence.